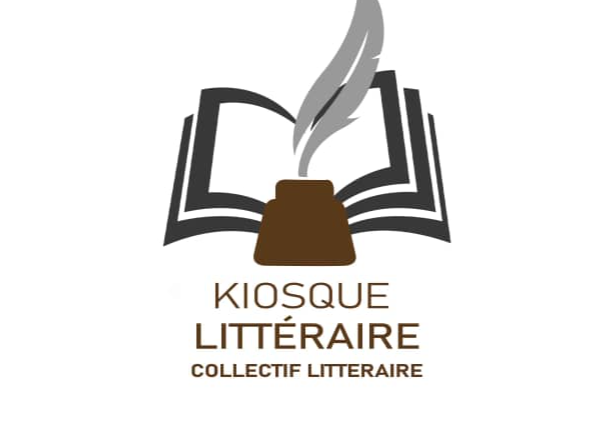Au sujet d'un monde ouvert
La mondialisation, présentée comme une ouverture et un échange entre les peuples, masque en réalité un universalisme imposé par les puissances dominantes, au détriment des cultures faibles, invitant l’Afrique à s’affirmer et à bâtir son propre modèle.

De nos jours, le monde est perçu comme un village dans lequel les habitants sont interconnectés. Ce village est en mouvement et en perpétuel changement. Certains penseurs désignent cette manière de vivre par le terme mondialisation, d'autres par globalisation. La mondialisation ou globalisation est en réalité la volonté de faire du monde un seul village où tous les habitants seraient des citoyens à part entière. Un monde dans lequel les frontières sont abolies et où la circulation des biens et des services est accessible à tous.
En somme, la mondialisation, aujourd’hui, place tout un chacun au carrefour d'une infinité de possibilités d’interaction et d’échange entre les nations, les langues, les sociétés et les cultures. Dans un monde ouvert, l’humanité dans sa diversité constitue le fondement de cette idéologie. Autrement dit, la diversité des cultures, des sociétés et des langues est ici la base de cette philosophie du monde ouvert. Mais une question demeure, pressante et essentielle : à qui profite cette mondialisation ?
À vrai dire, il devient de plus en plus difficile, dans la pratique, de mettre en œuvre cette mondialisation. Celle-ci tend à devenir un universalisme de vie auquel chacun devrait se conformer. Pourtant, la réalité montre que l’homogénéité socioculturelle est une richesse pour le monde. L’universalisme socio-politico-culturel semble être un avantage réservé à ceux qui en tirent les ficelles. Les pays développés s’enrichissent et imposent aux pays en voie de développement leurs lois, leurs cultures et leurs formes de citoyenneté.
La problématique de cet universalisme réside dans la suppression des cultures et des sociétés non dominantes. Lorsqu’un peuple ne s’affirme pas ou ne parvient pas à s’imposer, il devient réceptacle des lois et des cultures venues d’ailleurs.
Par ailleurs, au-delà de cet universalisme socio-politico-culturel, la mondialisation dissimule un séparatisme entre pays puissants et pays dits non puissants. Ce séparatisme entrave la mise en œuvre d'une mondialisation équitable, car il est le produit du capitalisme. Ce dernier place le capital au-dessus de la collaboration et des relations franches entre individus ou États. Chaque composante du monde ouvert devient un capital potentiel, un objet à séduire à des fins socio-économiques.
De même, chaque société cherche à imposer sa langue ou sa culture. Ainsi, les pays africains, historiquement colonisés, se trouvent dans une position de faiblesse qui les oblige à s'affirmer pour dire non à toute forme de prétention néocoloniale.
Un monde ouvert est celui où les individus sont de véritables partenaires. Un monde dans lequel chaque peuple, chaque culture, chaque société constitue une pièce indispensable du puzzle. C’est un monde qui rejette toute relation verticale et toute exploitation des plus faibles.
Pour mieux vivre cette mondialisation, celle-ci doit être une décision librement choisie, et non imposée. Pourtant, tel n’est pas le cas pour l’Afrique. Dans cette idéologie d’un monde sans frontières, l’Afrique doit s’ouvrir, marquer de son empreinte l’histoire du monde, et affirmer sa propre voie. Elle ne doit pas subir ce que font les autres, mais réinventer son modèle de vie à partir de ses propres réalités.
Faustin Mbuyu
Powered by Froala Editor